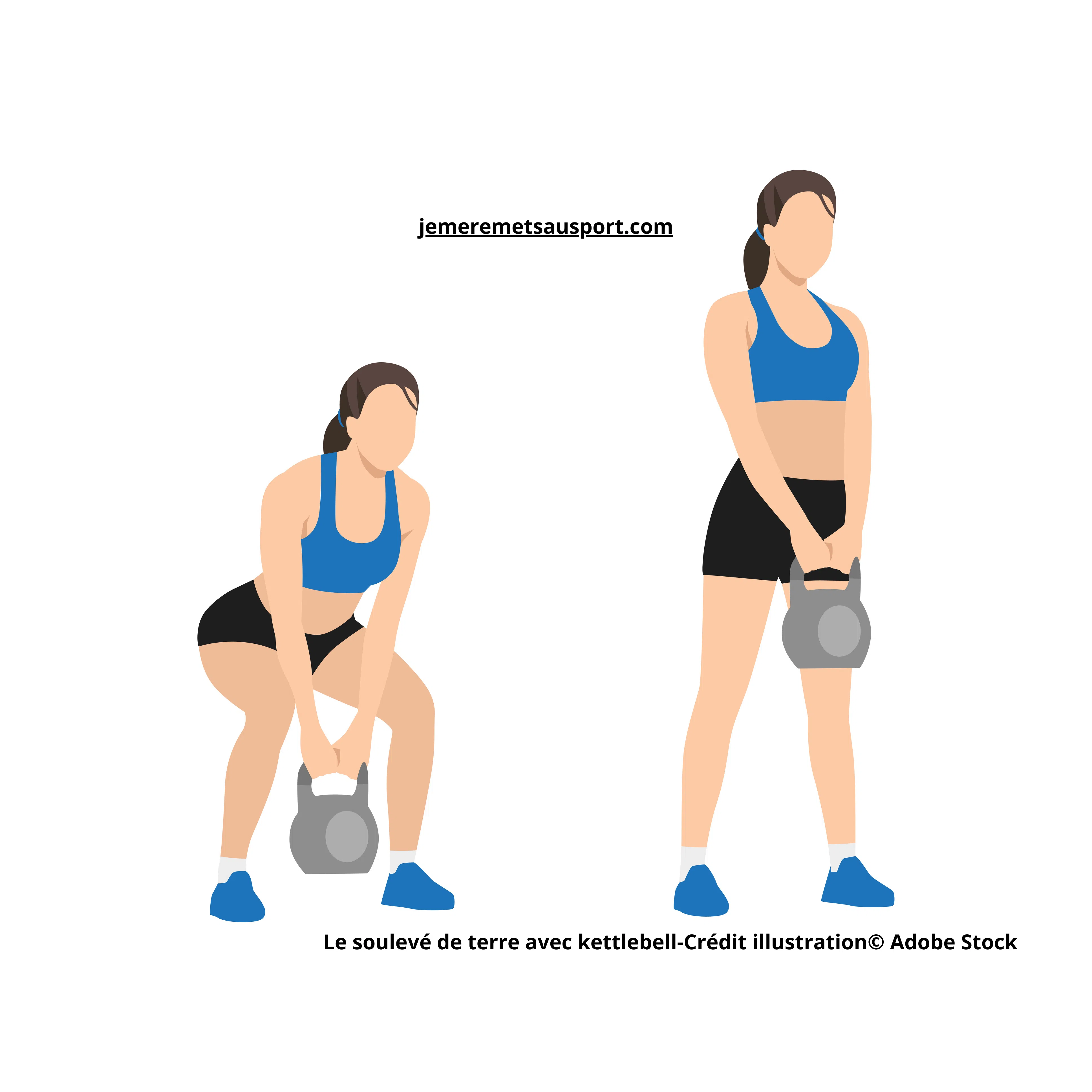La lucite estivale (souvent incluse dans la « polymorphic light eruption », PLE) est une réaction cutanée retardée aux UV, typique des premières expositions printanières: éruption prurigineuse sur les zones nouvellement exposées, qui tend à s’atténuer au fil de la saison. Elle est considérée comme la photodermatose idiopathique la plus fréquente.
Premiers rayons, premiers entraînements dehors… et premières plaques qui démangent. Les lucites chez les sportifs , ces réactions immunitaires “allergies au soleil” allant de la lucite estivale bénigne à l’urticaire solaire ou aux réactions de photosensibilisation , gâchent la préparation, forcent à lever le pied et, parfois, imposent l’arrêt de la compétition. Bonne nouvelle : on peut comprendre, prévenir et traiter sans renoncer au plein air.
Définition et symptômes des lucites
Sous le terme “lucites”, on regroupe des démangeaisons déclenchées par la lumière (UV surtout) : la lucite estivale bénigne (LEB), la lucite polymorphe (aussi appelée polymorphic light eruption, PLE), l’urticaire solaire, et les photosensibilisations médicamenteuses ou de contact. Toutes peuvent concerner les sportifs, en particulier ceux qui s’entraînent longtemps dehors, au bord de l’eau ou sur la neige. La lucite estivale bénigne touche surtout le décolleté, les épaules et les bras, après les premières expositions du printemps-été. La lucite polymorphe a des formes variées (papules, plaques, parfois vésicules) et récidive chaque année. L’urticaire solaire, plus rare, provoque une éruption papuleuse : des papules prurigineuses immédiates (minutes).
Qu’appelle-t-on UVA, UVB, SPF et UPF ?
-
UVA : rayons ultraviolets de 315–400 nm. Ils pénètrent plus profondément que les UVB, traversent largement les nuages… et, selon le type de vitrage, une partie passe au travers d’une vitre (d’où les expositions “à l’intérieur” près d’une fenêtre). On distingue parfois UVA2 (320–340 nm) et UVA1 (340–400 nm). Les UVA participent aux lucites et au photo-vieillissement.
-
UVB : rayons de 280–315 nm. Ils sont plus érythématogènes (responsables du coup de soleil) mais sont en grande partie absorbés par l’atmosphère (et par la plupart des vitrages). UVA et UVB contribuent au risque de lésions cutanées à long terme.
-
SPF (Sun Protection Factor) : indice mesuré in vivo (norme ISO 24444) qui quantifie la protection contre l’érythème UVB. Concrètement, le SPF compare la dose d’UV nécessaire pour provoquer un coup de soleil sur peau protégée vs non protégée. Il ne correspond pas à un temps précis passé au soleil (le “x minutes” est un mythe), car l’intensité UV varie selon l’heure, la latitude, l’altitude, etc. Pour être protégé aussi contre les UVA, il faut un produit “large spectre” dont la performance UVA est vérifiée (méthode ISO 24443 en laboratoire). Les mentions “résistant à l’eau” s’évaluent via ISO 16217/18861.
-
UPF (Ultraviolet Protection Factor) : équivalent du SPF pour les textiles. Il indique la fraction d’UV (UVA+UVB) que laisse passer le tissu. En Europe, les normes EN 13758-1/-2 encadrent la mesure et l’étiquetage des vêtements anti-UV. Un UPF 50+ laisse passer moins de 2 % des UV mesurés en test. À retenir : la protection dépend de la densité, de la couleur et de l’état du tissu ; elle peut diminuer quand le vêtement est mouillé, étiré ou usé. L’étiquette “UPF 40+” (ou plus) est généralement requise pour revendiquer une protection vestimentaire en Europe.
Qui est touché par la lucite estivale ?
La prévalence moyenne de la PLE autour de 10 % dans la population générale (intervalle 6–15 % selon les études et les régions). Les chiffres varient fortement selon la latitude et les habitudes d’exposition.
Une enquête multicentrique européenne (6 895 personnes) a rapporté qu’environ 18 % des Européens déclaraient des antécédents compatibles avec la PLE.
En France, la Société Française de Dermatologie rappelle dans un communiqué 2024 que les « allergies solaires » réapparaissent aux premiers rayons et dresse le portrait des personnes typiquement concernées.
La lucite estivale est-elle « fréquente »?
Oui, surtout en climat tempéré: ordre de grandeur 1 personne sur 10 au cours de la vie, avec de fortes variations locales.
Profils les plus concernés
Sexe et âge
La lucite estivale touche préférentiellement les femmes jeunes adultes et débute souvent au début de l’âge adulte, avec récidives saisonnières. Ce profil ressort à la fois des séries cliniques et des documents institutionnels.
Phototype et « peau sensible »
Les phototypes clairs (peaux claires qui prennent facilement des coups de soleil) sont surreprésentés en climat tempéré, là où la reprise au printemps est brutale après l’hiver. Tous les phototypes peuvent néanmoins être concernés si la dose d’UV déclenchante est atteinte.
Enfants et adolescents
Les enfants peuvent présenter des tableaux apparentés. On décrit notamment la photodermatose printanière juvénile (« juvenile spring eruption ») touchant les pavillons d’oreilles, surtout chez les garçons, au printemps par temps ensoleillé et frais; c’est souvent auto-limité. Les adolescents peuvent développer une lucite estivale « classique » lors des premières expositions.
Les enfants sont-ils souvent touchés par la lucite estivale?
Ils sont moins représentés que les jeunes adultes, mais une variante juvénile des oreilles est bien documentée et généralement transitoire.
Prédisposition génétique: ce que l’on sait (et ce qu’on ne sait pas)
Des formes familiales sont observées en pratique, ce qui fait suspecter un terrain génétique. Une entité héréditaire distincte, la HPLE (« hereditary polymorphic light eruption »), a été décrite chez des populations amérindiennes et inuites, avec une transmission autosomique dominante. Cette forme n’explique pas à elle seule la PLE courante en Europe; il n’existe pas aujourd’hui de test génétique simple pour prédire le risque individuel.
A-t-on identifié un gène unique de la lucite estivale?
Non: les données soutiennent plutôt une susceptibilité multifactorielle, modulée par l’environnement (dose d’UV, latitude, habitudes d’exposition).
Latitude, environnement et mode de vie
La fréquence observée augmente dans les régions de latitude moyenne où la reprise d’UV au printemps est rapide; les milieux réfléchissants (neige, sable, eau) amplifient la dose reçue et favorisent les poussées initiales, surtout chez les peaux claires.
Pourquoi les « premiers rayons » déclenchent-ils autant?
Parce que la peau n’est pas « entraînée »: l’exposition graduelle et la photoprotection réduisent le risque de déclenchement à cette période
Pourquoi les sportifs sont-ils particulièrement exposés ?
Durée d’exposition solaire et surfaces réfléchissantes
L’entraînement prolongé multiplie les UV reçus. Certaines surfaces renvoient une partie des UV vers la peau : l’eau renvoie moins de 10 %, le sable ~15 %, l’écume ~25 %, la neige fraîche peut quasiment doubler la dose reçue. Les sports nautiques et de neige exposent donc davantage les zones découvertes (visage, nuque, mains).
Altitude, météo, saison
En altitude, l’UV augmente d’environ 10 % tous les 1000 m et la neige réfléchit fortement; le printemps est la période “piège” des premières poussées de lucites chez les sportifs de montagne. Les UVA traversent les nuages : ciel voilé ≠ faible UV.
Sueur, eau, frottements
La sueur et l’eau diluent et emportent la crème; les frottements (maillot, bretelles, combinaison) démaquillent la protection aux points de pression. Les normes ISO 16217 et 18861 définissent la “résistance à l’eau” des solaires: un produit peut rester protecteur après immersion, mais nécessite réapplication en situation réelle d’effort. Bonne nouvelle côté performance : des études récentes montrent que la crème solaire n’altère ni la sudation ni la thermorégulation pendant l’exercice.
Combien de personnes concernées par la lucite estivale?
La lucite polymorphe est la photodermatose la plus courante en Europe, avec une prévalence estimée entre 10 et 20 % selon les séries, et une nette prédominance féminine, surtout en climats tempérés. D’autres travaux rapportent des chiffres variés selon les populations étudiées.
L’urticaire solaire est beaucoup plus rare : elle représente quelques pourcents des photodermatoses vues en consultation spécialisée et environ 0,5 % de l’ensemble des urticaires; des cohortes récentes confirment sa rareté mais aussi l’impact fonctionnel chez les personnes actives.
Identifier les différentes lucites chez les sportifs
Lucite estivale bénigne (LEB)
Survient 12–24 h après les premières expositions de la saison, surtout sur décolleté, épaules, bras; le visage est souvent épargné chez l’adulte. Démange fortement, régresse en quelques jours si l’exposition cesse, et revient chaque année.
Lucite polymorphe (PLE)
Tableau polymorphe (papules, plaques, parfois vésicules), prurigineux, sur zones nouvellement exposées au printemps/été; récidive saisonnière. Chez le sportif, on la voit typiquement sur les avant-bras et le cou des coureurs, ou les cuisses chez les cyclistes.
Urticaire solaire
Papules urticariennes immédiates (minutes) après exposition à la lumière (UV ou visible). Les sportives et sportifs rapportent un déclenchement dès l’échauffement au soleil. Les antihistaminiques sont la première ligne; des cas réfractaires répondent à l’omalizumab dans des séries rétrospectives.
Photosensibilisation (médicamenteuse ou de contact)
Deux mécanismes : phototoxicité (dommage direct) et photoallergie (réponse immunitaire). Côté médicaments : doxycycline et autres tétracyclines, thiazidiques, amiodarone, rétinoïdes, AINS(anti-inflammatoires non stéroidiens); côté topique : gels au kétoprofène, certains filtres UV (benzophénone-3/oxybenzone, octocrylène) en photoallergie. L’exposition sportive accroît le risque (UV + sueur + frottements).
Quels sports sont les plus à risque de lucites chez les sportifs ?
Ceux qui cumulent longue exposition et réflexion des UV : surf, voile, natation eau libre, trail, cyclisme, tennis, ski et alpinisme.
Diagnostic : quand consulter et quels examens ?
Le diagnostic est clinique (lien temporel avec l’exposition, localisation des lésions). En cas de doute, ou si l’on suspecte un filtre solaire ou un gel topique comme déclencheur, un bilan dans une consultation spécialisée de photodermatologie peut inclure phototests (détermination des doses minimales érythémales) et surtout photopatch-tests pour dépister une photoallergie de contact (ex. octocrylène, benzophénone-3, kétoprofène).
Faut-il faire une biopsie ?
Rarement, seulement pour écarter un autre diagnostic (ex. lupus cutané) selon l’examen clinique.
Prévenir les lucites chez les sportifs : méthode en 3 volets
1) Comportements “intelligents UV”
• Planifier les séances hors pics UV (généralement 12–16 h en été, France) et suivre l’indice UV du jour.
• Reprendre dehors progressivement en début de saison (expositions fractionnées).
• Rechercher l’ombre aux pauses; adapter les parcours (lisières, versants).
• Sur neige et sur l’eau, considérer l’UV réfléchi et protéger systématiquement visage et lèvres.
2) Équipement qui protège (UPF, lunettes, couvre-chef)
• Vêtements antiUV :des textiles anti-UV certifiés (UPF 40–50+), conformes au standard EN 13758-1/-2; manches longues respirantes pour la course/cyclisme, “rash guards” pour sports nautiques.
• Casquette “légionnaire” ou chapeau à large bord; lunettes UV400 catégorie 3 autorisées dans la plupart des sports.
• Gants fins (vélo, voile), tour de cou léger, lèvres SPF 50+.
Comment choisir un vêtement anti-UV ?
Vérifier le marquage EN 13758-2 et un UPF ≥ 40 (idéalement 50+). Les tissus denses, foncés ou traités anti-UV protègent mieux; mouillés, certains tissus perdent une partie de leur UPF.
3) Produits solaires : mode d’emploi “sport”
• Choisir un large spectre SPF 50+ avec haute protection UVA; préférer les textures résistantes à l’eau/sueur testées selon ISO 16217/18861.
• Quantité : viser ~2 mg/cm². Raccourci utile : “règle des deux doigts” par zone (visage/cou, chaque bras, chaque face de jambe, etc.).
• Application : 20–30 min avant l’effort, puis réapplication toutes les 2 h en extérieur et après baignade, sueur abondante ou frottements.
• Zones oubliées : oreilles, nuque, tempes, nez, dos des mains, dessus des pieds, sous les bretelles.
• En cas d’antécédent de photoallergie aux filtres organiques (octocrylène, benzophénone-3), envisager des filtres minéraux (oxyde de zinc, dioxyde de titane), peu rapportés comme photoallergisants.
• Performance : les produits solaires n’entravent pas la thermorégulation ni la sudation pendant l’exercice selon des données expérimentales récentes.
Les “résistants à l’eau” tiennent-ils vraiment pendant un triathlon ?
La norme ISO permet d’affirmer une tenue après immersion; en pratique, combiner crème résistante à l’eau + réapplication en T1/T2 ou au moins sur les zones clés reste la stratégie la plus sûre.
Que faire pour soulager une poussée pendant l’entraînement ou la compétition ?
-
Sortir immédiatement du soleil, se couvrir, refroidir la peau.
-
Antihistaminique oral (urticaire solaire) si déjà conseillé par votre médecin; surveiller l’apparition de signes systémiques (étourdissement, gêne respiratoire).
-
Corticoïde topique de courte durée sur les lésions inflammatoires (LEB/PLE).
-
Hydrater, éviter de gratter; reprendre progressivement quand les signes régressent.
-
Si les poussées se répètent, consulter pour bilan (phototests/photopatch-tests) et plan de prévention individualisé.
Stratégies de fond avant la saison : quand les lucites chez les sportifs récidivent
Chez les athlètes qui récidivent chaque printemps, deux approches complémentaires, médicales, peuvent être discutées avec un dermatologue :
• Photothérapie “durs d’UV” (durcissement) au printemps : nb-UVB (311 nm) ou PUVA en protocoles courts; des séries montrent une prévention efficace des poussées saisonnières chez les PLE. Organisation 4–6 semaines avant la reprise.
• Hydroxychloroquine (antipaludéen de synthèse) en prophylaxie des PLE/LEB, sur quelques semaines autour de la période d’exposition, avec un rapport bénéfice/risque à discuter (surveillance ophtalmologique si prolongation). Un essai randomisé a montré une supériorité vs chloroquine.>>> A ne pas prendre que sur prescription médicale
Dans des urticaires solaires réfractaires aux antihistaminiques, des séries de cas et cohortes explorent l’utilisation d’omalizumab (anti-IgE) avec des réponses cliniques intéressantes; décision au cas par cas en milieu spécialisé.
À retenir:
• Planifier tôt : consultation pré-saison si récidives.
• Équiper le sac : stick lèvres SPF 50+, mini-tube crème, lunettes UV400, casquette, haut UPF 50+.
• Penser “routine” : application 20–30 min avant, réapplication programmée, zones oubliées.
• Reprendre dehors progressivement; sur eau/neige, protection intégrale même par temps nuageux.
Médicaments et produits “à risque” pour les lucites chez les sportifs
Quels traitements augmentent la sensibilité au soleil ?
• Antibiotiques (tétracyclines, notamment doxycycline).
• Diurétiques thiazidiques, amiodarone, rétinoïdes.
• AINS : le kétoprofène topique est un classique des photoallergies en Europe.
• Huiles essentielles et plantes (agrumes: phytophotodermatites).
Que faire ? Parler “photosensibilité” lors de toute prescription avant un stage ou une compétition au soleil; envisager des alternatives quand possible; proscrire les gels au kétoprofène sous soleil.
Erreurs fréquentes:
• Appliquer trop peu de crème (protection réelle divisée par 2–3).
• Oublier les lèvres, les oreilles, le dessus des pieds.
• Croire qu’un ciel voilé protège.
• Réappliquer sans sécher la peau ruisselante (faible adhérence).
• Mettre un gel topique AINS puis s’exposer.
Tableau comparatif :sports, risques spécifiques et gestes clés
| Sport | Risque UV spécifique | Geste clé de prévention |
|---|---|---|
| Course route/trail | Exposition prolongée, zones “oubliées” (nuque, oreilles) | Casquette + lunettes UV400, haut UPF 50+, réapplication au ravito |
| Cyclisme route/GRAVEL | Réflexion du bitume, vent qui “oublie” la sensation de brûlure | Manches longues respirantes, gants, stick lèvres, crème sur nez/oreilles |
| Voile/surf/natation eau libre | Réflexion eau/écume, démaquillage rapide | Rash guard UPF 50+, crème résistante à l’eau, réapplication à terre |
| Ski/alpinisme | Réflexion neige (dose UV x2), altitude | Masque catégorie 3–4, écran total visage/lèvres, cagoule légère |
| Tennis/padel | Pic UV en journée, surfaces claires | Short manches longues légères, chapeau large, réapplication à chaque set |
La réflexion de l’eau (<10 %), du sable (~15 %), de l’écume (~25 %) et de la neige (jusqu’à ~80–100 % d’UV reçus en plus) explique les différences de risque entre disciplines
FAQ
La lucite estivale est-elle une “vraie” allergie ?
Pas au sens strict d’une allergie IgE immédiate. C’est une photodermatose retardée, immuno-médiée, déclenchée par les UV.
La peau s’habitue-t-elle d’elle-même ?
Souvent oui : les poussées diminuent avec l’exposition répétée au cours de l’été, d’où l’intérêt d’une exposition progressive.
Faut-il éviter totalement le soleil si j’ai déjà fait une lucite estivale ?
Non, mais il faut structurer l’exposition (progressivité, vêtements, crème) et surveiller les signaux de la peau. En cas de récidives sévères, discutez d’une photothérapie préventive.
Quelle crème choisir pour la prévention de la lucite estivale ?
Un SPF 50+ large spectre, idéalement « résistant à l’eau » selon ISO 16217/18861, et une texture compatible avec votre activité pour assurer la bonne quantité et la réapplication.
Les vêtements anti-UV sont-ils plus efficaces que la crème ?
Ils offrent une protection constante, indépendante de l’application, mais ne couvrent pas tout. Le meilleur résultat vient de la combinaison vêtements + crème + gestion des horaires.
Peau claire : risque plus élevé ?
Oui, les peaux claires rapportent plus souvent de lucite estivale, mais tous les phototypes peuvent être concernés. La prévention reste la même, en insistant sur l’exposition progressive.
La lucite estivale est une « allergie au soleil » fréquente: une réaction cutanée immunitaire déclenchée par le rayonnement ultraviolet (UVA et UVB),parfois renforcée par une part de lumière visible pouvant même traverser une vitre ,qui provoque, chez l’adulte jeune (souvent de jeunes femmes à peau claire, peau sensible) mais pouvant survenir à tout âge, une éruption cutanée papuleuse faite de petits boutons rouges très prurigineux avec sensation de brûlure sur les zones exposées au soleil (décolleté, épaules, avant-bras, dos des mains), au début de la belle saison; ce n’est pas un coup de soleil.
Les lucites chez les sportifs ne sont ni une fatalité, ni une raison d’abandonner les terrains, sentiers et plans d’eau. Comprendre votre forme de lucite (LEB/PLE), traquer les expositions “pièges” (eau, neige, altitudes, premiers soleils), associer textile UPF 50+ et solaire large spectre bien utilisé, puis prévoir un plan “poussée” clair permet de continuer à performer dehors.
Contrairement à la lucite qui récidive surtout au printemps et tend à s’atténuer avec l’exposition progressive de la peau, l’urticaire solaire (véritable réaction allergique immédiate) démarre en minutes, et d’autres diagnostics( comme le lupus érythémateux ou autres dermatose chroniques photosensibles) doivent être écartés en consultation médicale. Des facteurs déclenchants favorisent la poussée: exposition au soleil brutale, temps froid mais ensoleillé, altitude, réflexion par l’eau ou le sable, certains produits (ex. acide para-aminobenzoïque dans d’anciens solaires) et une possible prédisposition génétique. La prévention de la lucite repose sur la protection solaire combinée: s’exposer au soleil de façon progressive, appliquer généreusement une crème solaire large spectre et la renouveler, se protéger du soleil avec des vêtements anti-UV et un chapeau à large bord; un médecin généraliste ou un dermatologue peut aider à préparer la saison de plein air et proposer, si besoin, un traitement préventif (photothérapie, antipaludéens de synthèse, parfois bêta-carotène) ou un traitement adapté en cas de poussée. Chaque année en France, ces allergies au soleil rappellent qu’une bonne protection solaire et une application de crème régulière sont les réflexes clés pour les personnes les plus exposées au soleil.
Sources
- Oakley AM. Polymorphic Light Eruption. StatPearls. 2023.
- WHO. Ultraviolet radiation – Fact sheet. 2022. n
- WHO. Q&A: Ultraviolet radiation. Réflexion eau/sable/écume/neige. 2016.
- EPA (US). A Guide to the UV Index. 2010.
- Cancer Council Australia. Factors that affect UV radiation levels (consulté le 27/10/2025)
- EN 13758-1/-2 (UPF). Hohenstein Institute – European standard overview. 2025.
- ISO 16217:2020 & ISO 188612020. Water resistance of sunscreens. International Organization for Standardization.
- Di Bartolomeo L et al. Drug-induced photosensitivity. Frontiers in Allergy. 2022.
- British Photodermatology Group. Photopatch testing—methods and indications (workshop report). 2019.
- Pesqué D et al. Solar Urticaria: Ambispective Cohort. Acta Derm Venereol. 2024.
- Gilaberte Y et al. Photoprotection in Outdoor Sports: Review. Int J Environ Res Public Health. 2022.
- Fisher KG et al. Sunscreen does not alter sweating responses. J Appl Physiol. 2024.
- Orphanet. Solar urticaria. Prevalence unknown; part of photodermatoses.