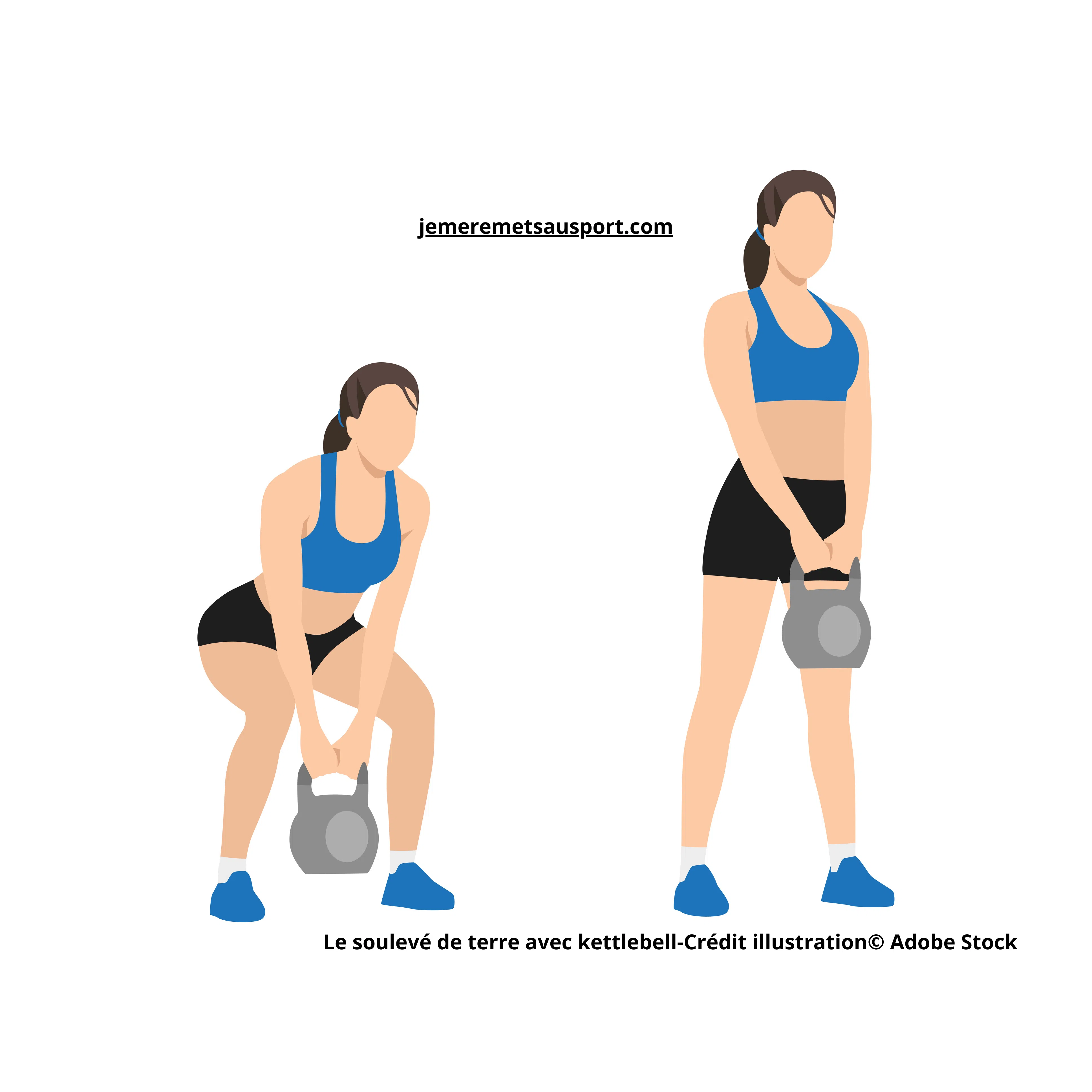Chez un sportif amateur comme chez un athlète confirmé, un petit détail peut bouleverser l’entraînement. On pense souvent à une tendinite, une entorse ou une fracture de fatigue lorsqu’une douleur au pied apparaît. Pourtant, une verrue plantaire, lésion cutanée bénigne mais douloureuse, peut devenir un vrai frein à la pratique sportive.
Invisible dans les chaussures, elle perturbe la foulée, modifie la posture et réduit les performances. Pire, elle peut conduire à un arrêt temporaire de l’activité.
Qu’est-ce qu’une verrue plantaire ?
Une verrue plantaire est une excroissance cutanée bénigne, liée à une infection par le papillomavirus humain (HPV), qui se développe sur la plante du pied. Sous l’effet de la pression corporelle, elle s’enfonce dans la peau plutôt que de ressortir comme d’autres verrues.
Caractéristiques cliniques
- Aspect aplati, parfois caché sous un épaississement de peau (hyperkératose).
- Présence de petits points noirs (micro-capillaires thromboses), surnommés “graines de verrue”.
- Douleur à la pression, donnant la sensation de marcher sur un caillou.
- Verrue unique ou en mosaïque (plusieurs verrues regroupées).
- Risque de confusion avec un cor ou un durillon.
Quelles sont les causes des verrues plantaires ?
Les verrues plantaires ne sont pas dues à un simple frottement ou à la transpiration. Leur origine est virale.
Le rôle du papillomavirus humain (HPV)
Le papillomavirus humain (HPV) est une grande famille comprenant plus de 200 génotypes. Ces virus se divisent en deux catégories principales :
- HPV cutanés : responsables des verrues (dont les verrues plantaires).
- HPV mucosaux : présents sur les muqueuses, certains sont oncogènes (ex. HPV 16 et 18, liés au cancer du col de l’utérus).
Selon le Collège des enseignants en dermatologie de France (Ann Dermatol Venereol. 2012;139(11 Suppl):A158-63), les verrues plantaires sont causées par des HPV cutanés non oncogènes, principalement les types HPV 1, 2, 4, 27 et 57. Ces virus infectent les cellules basales de l’épiderme, se multiplient et provoquent l’épaississement typique de la peau.
Une infection différente des HPV oncogènes
Contrairement aux HPV à haut risque (HPV 16, 18) impliqués dans le cancer du col de l’utérus et certaines tumeurs ORL, les HPV cutanés responsables des verrues plantaires sont sans lien avec ces formes cancéreuses. La verrue plantaire, bien que gênante, n’a donc pas de potentiel cancérigène.
Transmission du virus
-
Le HPV se transmet par contact direct peau à peau ou par contact indirect, via une surface contaminée (douche, tapis de sport, piscine).
-
Le virus pénètre dans la peau à travers une petite fissure, coupure ou abrasion souvent invisible à l’œil nu.
-
Contrairement à une croyance courante, ce n’est pas le simple fait de marcher pieds nus qui cause la verrue, mais bien la combinaison “virus présent + micro-lésion cutanée”.
Facteurs liés au sport
-
Milieux humides collectifs : vestiaires, douches, piscines, tatamis sont des lieux idéaux pour la survie du HPV.
-
Microtraumatismes répétés : les frottements de la chaussure, les pressions intenses et la sueur fragilisent la peau du pied.
-
Transpiration excessive (hyperhidrose plantaire) : l’humidité ramollit la peau, la rendant plus vulnérable aux micro-lésions et à l’inoculation du virus.
-
Partage de matériel ou d’équipements : serviettes, chaussettes, chaussures ou tapis de sport augmentent les risques de contamination croisée.
-
Fatigue et baisse immunitaire : un sportif en période d’entraînement intensif ou de compétition peut voir ses défenses immunitaires affaiblies, ce qui favorise l’installation du virus.
Facteurs individuels
-
Âge : les enfants, adolescents et jeunes adultes sont les plus touchés car leur système immunitaire n’a pas encore développé une tolérance complète face au HPV.
-
Système immunitaire affaibli : certaines maladies ou traitements (corticoïdes, immunosuppresseurs) rendent la guérison plus difficile.
-
Génétique et terrain cutané : certaines personnes développent plus facilement des kératoses et fissures, ce qui facilite la pénétration du virus.
En somme, la cause première est le HPV, mais c’est la combinaison de l’effort sportif, de l’humidité et des microtraumatismes qui favorise son apparition.
Épidémiologie et fréquence
- Dans la population générale, environ 7 à 10 % des personnes développent une verrue plantaire au cours de leur vie.
- Chez les sportifs, la prévalence est bien plus élevée : une étude a montré un taux allant jusqu’à 36,5 % dans certaines disciplines.
- Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont les plus touchés, du fait de leur activité et de leur système immunitaire encore en adaptation.
Impact des verrues plantaires sur la pratique sportive
Douleur et gêne mécanique
À chaque foulée, saut ou impulsion, la verrue provoque une douleur localisée. Cela peut pousser l’athlète à réduire son appui, perturbant ainsi sa foulée.
Compensation posturale
Pour éviter la douleur, le sportif modifie ses appuis. Cette compensation entraîne :
- surcharge du côté opposé
- déséquilibre postural
- apparition de nouvelles douleurs (genou, hanche, dos)
Baisse des performances
Une gêne minime mais répétée peut réduire la vitesse, la puissance d’impulsion et l’endurance.
Risque de blessure secondaire
Les compensations et le déséquilibre biomécanique augmentent le risque de tendinites ou de douleurs articulaires.
Contagion et propagation
Les verrues étant contagieuses, elles peuvent se transmettre entre coéquipiers dans les vestiaires ou via des surfaces partagées.
Impact psychologique
La gêne chronique et la crainte de contaminer les autres peuvent démotiver et affecter la concentration du sportif.
Prise en charge et traitement :
Approche “attentiste” et résolution spontanée
-
Il est estimé que jusqu’à 80 % des verrues plantaires peuvent disparaître spontanément en l’espace de deux ans.
- Dans un contexte sportif, il est essentiel d’agir avec pragmatisme : traiter la verrue, limiter la douleur, tout en permettant la poursuite (au moins partielle) de l’entraînement.
-
Toutefois, pour un sportif, attendre sans traitement peut être difficile à vivre et limiter durablement la performance.
Traitements topiques (première ligne)
-
Acide salicylique (en gel, patch) : agent kératolytique, il agit en enlevant progressivement les couches de peau infectée. Il est souvent utilisé quotidiennement sur plusieurs semaines à mois.
-
L’efficacité de l’acide salicylique est modeste : une méta-analyse a montré un gain d’environ 29 % par rapport à un placebo après 12 semaines.
-
Il existe des formules combinées (cantharidine, acide salicylique, podophyllotoxine) ou des acides plus forts (monochloroacétique) utilisées en milieu clinique.
Cryothérapie (azote liquide)
-
L’application de froid extrême provoque une destruction cellulaire au niveau de la lésion, ce qui déclenche une réponse immunitaire.
-
Bien que douloureux, elle est souvent plus efficace que les traitements topiques.
-
En sport, cela demande de prévoir une récupération, car des cloques ou des lésions secondaires sont possibles.
Injections, immunothérapie, techniques spécialisées
-
Des techniques plus avancées comme le laser, la thérapie par ondes électromagnétiques ou l’électrodessication sont aussi employées, surtout pour les verrues réfractaires.
-
Une étude de cas a utilisé un mélange botanique appliqué localement chez un joueur de football, avec des résultats intéressants, bien que ce soit un cas isolé.
Débridement et préparation de la lésion
Avant l’application d’un traitement, il est souvent utile d’éliminer les zones de peau morte (kératose) pour favoriser la pénétration du traitement. Cela peut se faire avec une lime, une pierre ponce stérile ou du matériel abrasif.
Mesures de soulagement et adaptations pour le sport
-
Anneaux de mousse (donuts) : plaqués autour de la verrue, ils déchargent la zone de pression.
-
Chaussures avec bon amorti, semelles plus souples pour répartir la charge
-
Alterner des sessions avec des sports à faible impact (natation, vélo)
-
Réduire temporairement la charge d’entraînement sur la jambe concernée
-
Adapter les séances : privilégier le travail technique, la musculation, le haut du corps
Suivi, persistance et récidive
-
Beaucoup de méthodes exigent plusieurs séances et patience
-
Certaines verrues peuvent résister, nécessiter un plan combiné
-
Le risque de récidive est réel — surveiller la zone traitée et les zones adjacentes
-
Maintenir une hygiène rigoureuse pour éviter la recontamination
Prévention des verrues plantaires chez le sportif
- Porter des sandales dans les vestiaires et douches collectives.
- Sécher soigneusement les pieds après l’effort.
- Utiliser des chaussettes respirantes adaptées au sport.
- Alterner les chaussures et les laisser sécher.
- Désinfecter le matériel partagé (tapis, tatamis, serviettes).
- Ne pas partager les affaires personnelles (chaussettes, serviettes).
- Traiter rapidement toute coupure ou fissure.
- Surveiller régulièrement la plante des pieds.
Cas pratiques
-
Un coureur d’endurance ressent une douleur au talon droit persistante. Au départ, il la compense en raccourcissant la foulée, ce qui surcharge le genou gauche, provoquant une tendinite. Le diagnostic ensuite révèle une verrue plantaire au talon. En traitant la verrue (acide salicylique + décharge locale) et en adaptant le plan d’entraînement, il parvient à revenir progressivement à l’intensité d’avant.
-
Un joueur de football avec une verrue sur l’avant-pied modifie sa technique de passe ou de course latérale pour éviter l’appui sur l’orteil concerné, ce qui affecte son efficacité technique et le rend plus vulnérable aux chocs du pied opposé.
-
Un nageur / triathlète combine risque de contact avec sol humide (piscine) + pression répétée (course). Il doit être particulièrement vigilant à ses pieds, porter des chaussons de piscine et soigner immédiatement toute lésion cutanée.
Conseils pratiques pour les sportifs atteints
- Consulter rapidement votre médecin.
- Ne pas gratter ni couper la verrue soi-même.
- Respecter la régularité du traitement.
- Adapter temporairement l’entraînement.
- Informer ses coéquipiers et adopter des mesures de prévention.
Conclusion
La verrue plantaire n’est pas une simple lésion bénigne : pour un sportif, elle peut devenir un véritable obstacle. Elle modifie la posture, perturbe la biomécanique, entraîne une baisse de performance et un risque de blessure secondaire.
La bonne nouvelle : des traitements existent et, associés à une prévention rigoureuse, ils permettent de limiter la durée d’impact sur la pratique sportive. Savoir reconnaître, traiter et prévenir les verrues plantaires est donc un atout pour tout sportif, qu’il soit amateur ou professionnel.